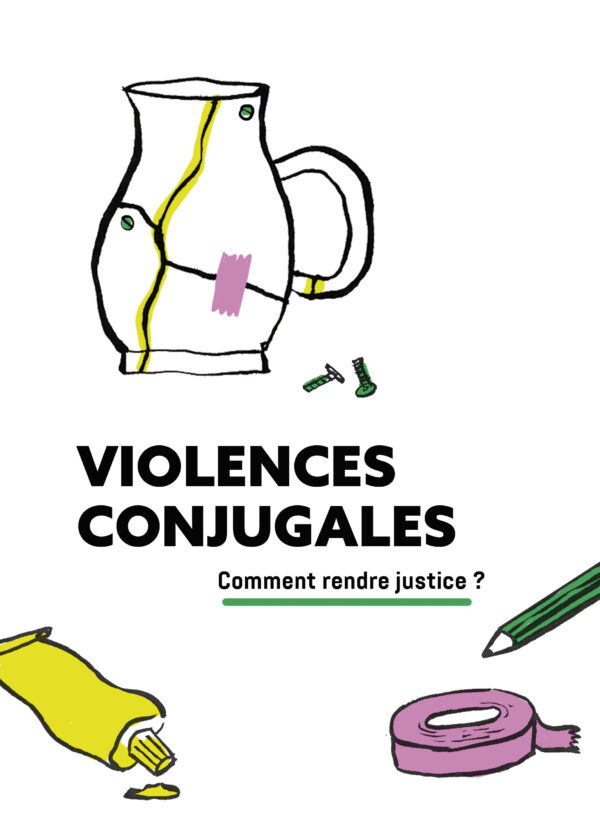Face aux violences conjugales qui touchent une femme sur trois en Belgique, la réponse pénale montre ses limites. Entre témoignages de victimes confrontées à une justice inadaptée, analyses abolitionnistes et expériences de justice transformatrice, la dernière Chronique de la Ligue des droits humains interroge radicalement notre manière de rendre justice. Peut-on vraiment combattre la violence par la violence ?
En Belgique, les chiffres glacent. Une femme sur trois de plus de 18 ans a déjà vécu des violences conjugales. Au moins 26 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint l’année dernière. Pourtant, lorsque Victoria et Kadiatou franchissent les portes du système judiciaire, elles découvrent une machine qui produit souvent plus de violence qu’elle n’en répare.
Quand la justice revictimise
Victoria a tout enduré pendant des mois : violences psychologiques, physiques, sexuelles, emprise totale. Lorsqu’elle porte plainte, la procédure révèle l’ampleur du contrôle : caméras de surveillance, piratage de comptes, traceur GPS, enregistrements des viols. Deux ans plus tard, elle attend toujours son procès, raconte Aline Wavreille (Après les coups, se relever pour défendre la vérité).
Pour Kadiatou, l’intervention policière a empiré la situation. Les agents minimisent, invitent à « régler ça entre vous ». Son ex-conjoint leur offre un café. « Il a vu que la police n’agirait pas contre lui », témoigne-t-elle. Au Centre de Prévention des Violences Conjugales, on confirme : les femmes noires, arabes, en difficulté socio-économique sont systématiquement moins bien prises en charge.
Devant les tribunaux, les agresseurs manipulent les institutions, épuisent les procédures. « Les juges laissent mon ex-conjoint dérouler ses mensonges. Pourquoi on le laisse parler alors que c’est moi la victime ? » En 2022, deux tiers des affaires ont été classées sans suite.
La prison aggrave ce qu’elle prétend réparer
Les discours réclament plus de répression. Or, l’incarcération renforce la récidive, exacerbe les émotions négatives, fabrique de l’hostilité, analyse Juliette Béghin (Le fléau de la violence conjugale). « Ajouter de la souffrance à la souffrance est un pur non-sens. »
L’institution carcérale accentue toutes les caractéristiques du patriarcat. Comment un auteur de violences peut-il remettre en question son comportement dans un lieu qui en amplifie tous les traits ? Les victimes le confirment : « J’aurais préféré des soins, un suivi, pas la prison car ça n’arrange rien. » Cette justice reste profondément inégalitaire : les hommes issus de milieux défavorisés, racisés, se retrouvent massivement derrière les barreaux.
Peut-on se passer du pénal ?
Face à ce constat, nombreux plaident pour des alternatives. Mais Diane Bernard invite à la nuance (Peut-on se passer du pénal ?). Le choix n’est pas évident. D’abord, distinguer le pénal de ses dysfonctionnements. On peut critiquer les classements sans suite, les stéréotypes, tout en reconnaissant un sens au principe des procédures. Ne pas confondre pénal et carcéral.
Les alternatives sont multiples. En Belgique : médiations réparatrices, médiations-mesures, dispositifs extrajudiciaires. Mais seul l’auteur peut refuser la médiation proposée, pas la victime. Cette asymétrie interroge.
Sur le fond, les fonctions diffèrent. Le pénal vise la réparation symbolique, la neutralisation, l’affirmation publique de valeurs. Les alternatives visent une reconstruction profonde, une transformation. Le pénal peut neutraliser mais son efficacité sur la récidive est contestée. Les alternatives peuvent transformer mais manquent du potentiel protecteur immédiat.
Surtout, le procès affirme publiquement l’inacceptable. Les alternatives, plus confidentielles, peinent à remplir cette fonction symbolique. Ne pas nommer publiquement les violences risque d’entretenir leur banalisation. Bernard souligne les risques : les alternatives peuvent reproduire les rapports de pouvoir, supposent une symétrie qui n’existe pas en cas d’emprise. La question n’est pas de choisir mais de réfléchir à leur articulation.
L’impasse structurelle du système pénal
Pour Margaux Coquet, qui développe une critique abolitionniste dans Le système pénal doit être interrompu plutôt que réparé, ces échecs sont structurels. Le système repose sur des mythes déconstruits par la recherche.
Premier mythe : son intervention serait nécessaire au maintien de l’ordre social. Or, la majorité des situations criminalisées sont déjà traitées ailleurs. Les alternatives sont donc déjà la règle. Deuxième mythe : la peine dissuaderait. Mais l’association entre punition et dissuasion relève de l’intuition. Les rares études concluent que la menace de la peine n’est efficace que pour ceux qui n’en ont pas besoin. Troisième mythe : la justice protégerait les victimes. En réalité, le processus pénal produit souvent une victimisation secondaire.
Le système reproduit les rapports de domination. Il criminalise à deux vitesses : les petits délits sont sévèrement réprimés, la criminalité économique, environnementale ou politique reste impunie. Les personnes pauvres, racisées ou étrangères sont surreprésentées. Il punit les individus en déconnectant artificiellement leur faute du contexte socio-économique, invisibilisant ainsi la pauvreté, l’exclusion, les addictions à l’origine des situations.
Le monopole étatique de la violence produit un désinvestissement social, une perte de compétences en gestion collective des conflits. L’abolitionnisme en déduit que le système est structurellement vicié. Les réformes n’ont fait qu’étendre son emprise. Il s’agit de l’interrompre et de créer d’autres formes de justice, indissociables des luttes pour la justice sociale, contre le capitalisme, la suprématie blanche, le patriarcat.
La justice transformatrice : reprendre le pouvoir sur nos conflits
Certaines victimes se détournent des institutions étatiques. En filigrane : ne pas ajouter de la violence à la violence. Emmanuelle de Buisseret Hardy explore ces alternatives (Se réapproprier les pratiques de justice). La justice transformatrice désigne ces pratiques collectives hors du pénal, issues des processus autochtones et des luttes queer, noires, anti-racistes. Le problème commence avec les conditions sociales qui rendent la violence possible.
Ruth Morris distingue deux types de victimes : celles de violences interpersonnelles et celles d’injustices systémiques. Le pénal reconnaît les premières, ignore les secondes. La justice transformatrice considère qu’il est de la responsabilité de la communauté de prendre en charge victime et auteur. Concrètement : un groupe de soutien à la victime, un groupe de responsabilisation de l’auteur.
Morris identifie cinq besoins : sécurité, réponses, reconnaissance, réparation collective, sens. Le pénal n’y répond pas. Cette approche se distingue de la justice restaurative, récupérée par le pénal, qui vise à restaurer un état antérieur déjà traversé par des dominations.
Une expérience en justice restaurative : promesses et limites
Mais que se passe-t-il concrètement dans un parcours de justice restaurative ? Luce Goutelle, chercheuse indépendante et initiatrice du projet Traverser/Transcender, livre un témoignage rare et précieux (Hors des sentiers battus. Une expérience en justice restaurative). Suite à des violences sexuelles, elle a poussé la porte d’un service d’accompagnement en justice restaurative, hors dépôt de plainte.
« Pourquoi ne pas porter plainte ? » D’innombrables personnes n’ont cessé de le lui répéter. Comme si porter plainte était le graal, comme si cela allait tout régler. « Même les agresseurs semblaient déconcertés par le fait que je ne porte pas plainte. J’ai eu le sentiment qu’ils préféraient presque être punis plutôt que l’espace de dialogue et de responsabilisation que je leur proposais. »
Goutelle rejoint la criminologue Anne Lemonne : il est problématique de conseiller par automatisme à une victime de porter plainte sans la prévenir du parcours qui l’attend. « Dans l’état actuel du système judiciaire, porter plainte est souvent vécu par les victimes comme une sur-violence. Les acteurs de la justice pénale l’avouent eux-mêmes : la justice pénale n’est pas conçue pour les victimes. Elle ne répare pas, elle punit, elle protège l’État. »
En Belgique, la justice restaurative est une forme de justice complémentaire ou alternative au pénal. Contrairement à la justice pénale qui punit, elle vise – quand les conditions sont réunies – à ouvrir un espace de communication entre auteurs et victimes, où les besoins et les émotions peuvent être exprimés dans un cadre sécurisant. Elle peut prendre une forme collective (victimes et auteurs concernés par les mêmes types de faits mais pas par les mêmes affaires) ou individuelle (communication entre personnes liées par la même affaire).
Goutelle a expérimenté la forme individuelle : des rendez-vous alternés avec les médiatrices, puis potentiellement une confrontation. « Ce que l’on ne m’a pas dit, c’est que la médiation est un sport de combat. Un entraînement sportif de haut niveau que je devais appréhender comme une athlète. »
Son témoignage révèle les limites de la justice restaurative. D’abord, la question de l’écoute : « Permettre un espace pour s’exprimer ne garantit pas que l’on sera pleinement écouté. Plus j’ai avancé, plus j’ai réalisé que j’étais face à des personnes en incapacité quasi-totale de sortir d’une posture égocentrique. Les violences n’étaient pas un ‘dérapage’ mais la continuité d’un comportement où l’empathie, la remise en question et l’écoute manquent cruellement. »
Ensuite, la responsabilisation des agresseurs : « Le cadre offre peu de marge pour agir sur leur responsabilisation. Les deux fois, j’étais face à un enfant qui attend qu’on le gronde. Seules la menace de la prison et leur image les inquiétaient. Les considérations sur les conséquences pour les victimes étaient rares, pour ne pas dire inexistantes. »
Concernant la reconnaissance et les réparations : « L’un a reconnu le viol, l’autre avoir ‘insisté’. J’ai appris que c’était extrêmement rare. Mais quand il a été question de réparations, les deux ont brillé par leur absence. La justice restaurative est mal outillée pour demander et obtenir des réparations – matérielles, financières ou symboliques. Pour améliorer cela, il faudrait créer des ponts avec des avocats et des services de responsabilisation des auteurs. »
Goutelle souligne aussi le décalage de temporalité : la victime qui initie la démarche a déjà beaucoup cheminé, contrairement à l’agresseur. Cette asymétrie est accentuée par le fait que les victimes sont très souvent accompagnées de manière thérapeutique, ce qui est rarement le cas des agresseurs. « En tant que victime, on apprend à s’exprimer en acceptant que l’agresseur ne réponde pas à la majorité de nos attentes. Dépendre de ce qu’il va être capable de dire serait lui donner trop de pouvoir. Le chemin est un retour vers soi, pour apprendre à se croire, à retrouver confiance. »
Elle conclut avec nuance : « Sans pouvoir trancher si l’expérience a été positive ou négative, elle m’a fait grandir. L’autoroute du droit pénal est inadaptée. Chercher une solution unique, c’est faire fausse route. Plus nous dessinerons de chemins possibles de réparations, plus nous avancerons. La justice restaurative en est un, avec ses limites. » Elle plaide pour mettre davantage en dialogue les différentes formes de justices – pénale, restaurative, transformatrice, alternative – et les articuler avec les diverses formes thérapeutiques. « Notre société, gangrénée par les violences sexuelles, aurait beaucoup à gagner à se donner les moyens de déployer ce chantier. »
Former et transformer
Cette approche demande des ressources considérables, difficiles à mobiliser dans nos sociétés capitalistes. Dès lors, bien que le système judiciaire ne constitue pas une réponse adaptée, il peut représenter pour les victimes une réponse crédible à leurs besoins de justice.
Pour celles qui s’y tournent, la formation des professionnels reste cruciale. Police, magistrats, avocats doivent comprendre les mécanismes des violences conjugales, l’emprise, le contrôle coercitif. Victoria témoigne : avec une avocate formée, tout change. « Elle m’explique les étapes, elle m’informe, elle me consulte. J’ai confiance. »
Les violences conjugales ne sont pas qu’un problème pénal. Elles sont économiques, sociales, de santé publique, de droits humains. Indissociables de nos structures patriarcales, de la culture du viol. La paupérisation croissante risque d’augmenter les violences. Les causes sont aussi liées à nos politiques socio-économiques.
Il devient urgent de se former à des approches communautaires et non-violentes, de mettre en place des réseaux de solidarité, de faire porter les luttes sur les conditions matérielles de l’émancipation des femmes. Il est urgent aussi de s’intéresser à l’emprise et au contrôle coercitif, non pour davantage punir mais pour mieux soutenir victimes et auteurs.
Comme le rappelle Audre Lorde : « Les outils du maître ne détruiront pas la maison du maître. » Si nous voulons vraiment combattre les violences conjugales, nous devons cesser de croire que la prison peut nous en protéger. Nous devons inventer d’autres manières de faire justice, qui ne reproduisent pas la violence qu’elles prétendent combattre. Des manières qui transforment nos communautés plutôt que de punir les individus. Entre l’impasse du pénal et les promesses des alternatives, entre la nécessité de protéger et celle de transformer, la question demeure : comment rendre justice sans ajouter de la violence à la violence ?
#ViolencesConjugales #Justice #Abolitionnisme #JusticeTransformatrice #DroitsDesFemmes #DroitsHumains #Prison #SystemePenal #Feminisme #JusticeSociale