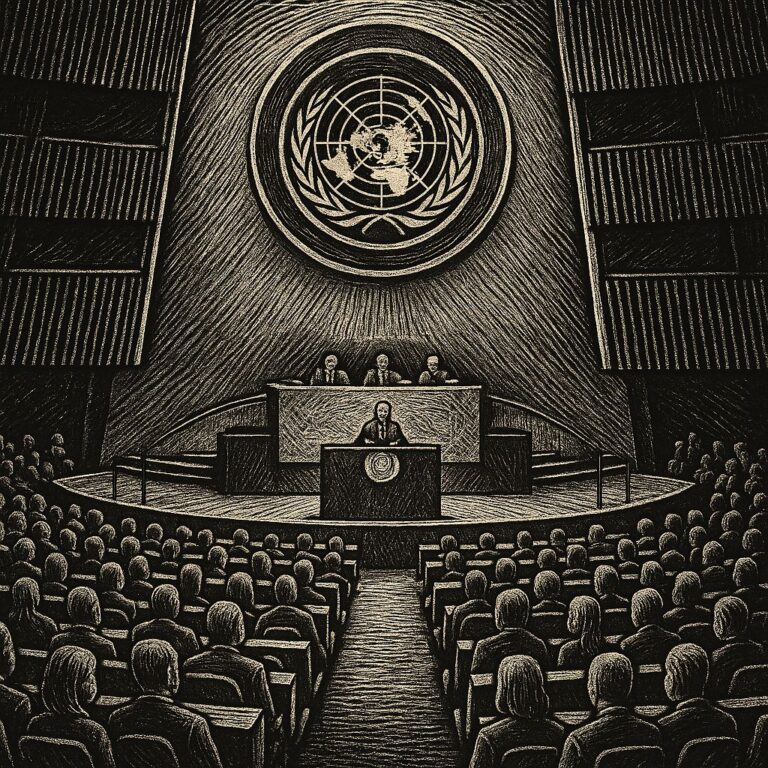Recension du rapport 2025 du Secrétaire général des Nations Unies
Vingt ans après l’adoption du principe de Responsabilité de Protéger (R2P) lors du Sommet mondial de 2005, le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres présente un bilan nuancé de cette doctrine révolutionnaire dans son rapport publié en avril 2025. Entre avancées conceptuelles significatives et défis opérationnels persistants, ce document offre une photographie saisissante de l’état actuel de la protection des populations civiles.
Le constat dressé par le rapport est sans appel : le monde traverse aujourd’hui le plus grand nombre de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette situation s’accompagne d’une détérioration marquée du respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme, tant par les acteurs étatiques que non-étatiques.
Chiffres révélateurs d’une crise humanitaire
Les données présentées témoignent de l’ampleur de la crise :
- 123 millions de personnes déplacées de force en octobre 2024, contre 37 millions en 2005
- 72 % d’augmentation des victimes civiles dans les conflits armés en 2023
- 7 victimes sur 10 enregistrées en Israël et dans le Territoire palestinien occupé
Ces statistiques reflètent une réalité où les principes fondamentaux du droit humanitaire – distinction, proportionnalité et précautions – sont systématiquement bafoués.
| Le principe de Responsabilité de Protéger (R2P) Lors du Sommet mondial de 2005, les chefs d’État et de gouvernement ont inscrit, dans les paragraphes 138-139 du Document final (résolution 60/1), le devoir pour chaque État de protéger sa population contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité. Ils ont aussi accepté d’aider les États incapables d’y parvenir et se sont déclarés prêts à agir collectivement, y compris par le Conseil de sécurité sous le Chapitre VII, lorsque les autorités nationales « manifestement » échouent. Ce consensus onusien fonde aujourd’hui les trois piliers de la R2P : responsabilité nationale, assistance internationale et réponse rapide et décisive. |
Le rapport souligne une transformation majeure : alors qu’en 2005 les conflits étaient principalement intra-étatiques, les conflits inter-étatiques impliquant des acteurs régionaux ou internationaux deviennent « une caractéristique de plus en plus significante » de l’environnement sécuritaire mondial.
Cette évolution complexifie considérablement l’application de la R2P, qui doit désormais s’adapter à des réalités géopolitiques mouvantes où les ramifications des conflits dépassent largement les frontières nationales.
Innovations technologiques et nouveaux défis
L’un des aspects les plus préoccupants identifiés concerne l’impact des nouvelles technologies sur la commission de crimes d’atrocité. Le rapport met en garde contre :
- L’utilisation de l’intelligence artificielle sur les champs de bataille
- La prolifération des véhicules aériens sans équipage
- L’exploitation des réseaux sociaux pour promouvoir la déshumanisation et l’incitation à la violence
- Les cyberattaques visant les infrastructures critiques
Ces évolutions technologiques posent des défis inédits en matière de responsabilité et d’imputabilité, rendant plus difficile l’identification des responsables et encourageant potentiellement l’usage de ces technologies.
Succès et bonnes pratiques : des raisons d’espérer
Malgré ce tableau sombre, le rapport met en lumière des avancées significatives dans la mise en œuvre de la R2P :
Mécanismes nationaux de prévention
Au moins douze États membres ont établi des mécanismes nationaux de prévention des crimes d’atrocité, s’alignant sur le Protocole de la Région des Grands Lacs. Ces initiatives nationales constituent l’épine dorsale d’une approche préventive efficace.
Réseaux régionaux et partenariats
- 61 pays ont nommé des points focaux R2P
- 56 États membres et l’Union européenne participent au Groupe d’Amis de la R2P
- Des réseaux comme Global Action against Mass Atrocity Crimes facilitent le partage de bonnes pratiques
Justice transitionnelle et réconciliation
Des pays comme l’Australie, le Canada, la Finlande, la Norvège, la Suède et récemment la Suisse ont reconnu leur responsabilité dans la commission de crimes contre les minorités nationales ou les peuples autochtones, démontrant l’importance d’une « gestion constructive de la diversité ».
Défis institutionnels et paralysie du Conseil de sécurité
Le rapport n’élude pas les dysfonctionnements institutionnels majeurs. La paralysie du Conseil de sécurité, notamment due à l’usage du droit de véto, entrave régulièrement les prises de décision efficaces et génère des « perceptions de deux poids, deux mesures ».
Face à cette impasse, plusieurs initiatives innovantes ont émergé :
- Résolution 76/262 de l’Assemblée générale exigeant une réunion formelle dans les 10 jours suivant un véto
- Code de conduite du Groupe ACT (Accountability, Coherence and Transparency)
- Initiative de retenue du véto en cas d’atrocités de masse
Recommandations stratégiques pour l’avenir
Le Secrétaire général identifie trois domaines d’action prioritaires :
- Mécanismes de prévention permanents au niveau national
- Consultations régionales pour partager expériences et leçons apprises
- Orientations stratégiques et techniques pour l’implémentation domestique, régionale et multilatérale
Implications pour les organisations et la société civile
Ce rapport revêt une importance particulière pour les ONG et organisations internationales. Il rappelle le rôle crucial de la société civile dans :
- La détection précoce des signaux d’alerte
- Le développement de stratégies de prévention à long terme
- La sensibilisation et la mobilisation communautaire
Conclusion : un appel à l’action renouvelé
Vingt ans après sa conception, la Responsabilité de Protéger demeure « un cadre pertinent pour l’action » malgré la détérioration du contexte international. Le rapport souligne que la conviction fondamentale sous-jacente à la R2P persiste, comme en témoignent les efforts décrits.
Cependant, face aux défis contemporains, de « nouvelles modalités de partenariats et méthodes de travail » s’imposent. L’engagement du Secrétaire général est clair : renforcer et intensifier les efforts individuels et conjoints des États membres pour prévenir les atrocités et protéger les populations.
Pour les acteurs de la coopération internationale et du développement, ce rapport constitue un appel pressant à intégrer une « perspective de prévention des atrocités » dans l’ensemble de leurs programmes et stratégies. Car comme le rappelle le document, notre bien-être global est « inextricablement lié au bien-être des plus vulnérables d’entre nous ».
Ce rapport complet est disponible sous la référence A/79/875-S/2025/248 et mérite une attention particulière de tous les acteurs engagés dans la protection des droits humains et la prévention des conflits.