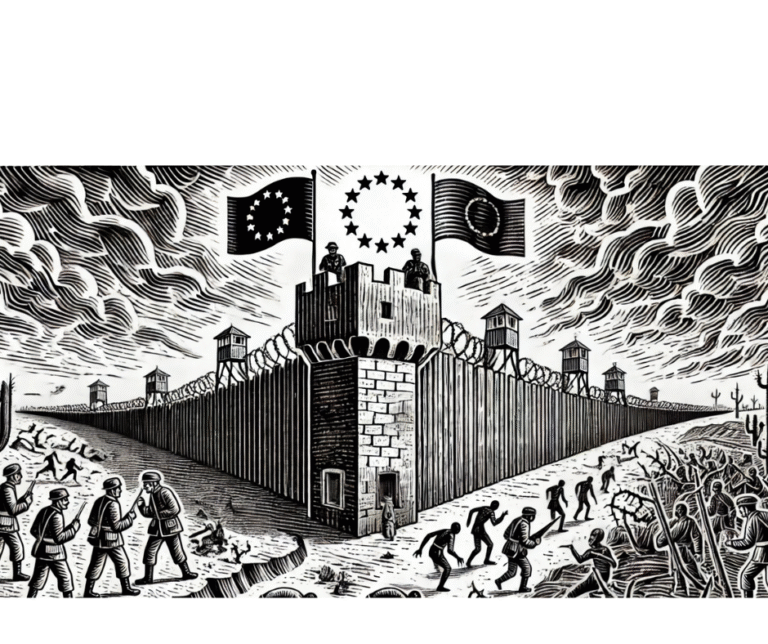La Commission européenne a dévoilé une première liste commune de pays tiers considérés comme « sûrs » pour les demandeurs d’asile. Cette initiative, présentée comme une harmonisation des politiques européennes en matière d’asile, suscite l’inquiétude des organisations de défense des droits humains qui y voient un recul majeur dans la protection des personnes vulnérables.
Une liste visant à faciliter les renvois
Mercredi dernier, la Commission européenne a rendu publique sa proposition de liste de « pays tiers sûrs ». Cette liste, une première du genre au niveau européen, vise à permettre aux États membres d’appliquer des procédures accélérées de renvoi pour les demandeurs d’asile originaires de ces pays. L’objectif affiché est de rationaliser le traitement des demandes et de concentrer les ressources sur les personnes réellement nécessitant une protection internationale.
La liste comprend actuellement plusieurs nations, dont la Tunisie, le Maroc et l’Égypte. Selon la Commission, ces pays offrent un niveau suffisant de protection aux droits fondamentaux et garantissent un traitement équitable aux demandeurs d’asile. Une fois finalisée et adoptée par le Conseil et le Parlement européens, cette liste deviendra contraignante pour tous les États membres de l’Union Européenne.
Le CNCD-11.11.11 dénonce une « dérive dangereuse »
L’annonce de cette liste a immédiatement suscité des réactions critiques, notamment de la part du CNCD-11.11.11. L’organisation déplore ce qu’elle considère comme un « tournant dangereux pour le droit d’asile » en Europe.
Pour le CNCD-11.11.11, cette initiative ne représente pas une véritable harmonisation des politiques d’asile, mais plutôt un « blanc-seing aux États membres pour vider de sa substance le droit d’asile ». L’organisation craint que la liste ne conduise à une diminution significative des garanties procédurales et à un affaiblissement de l’examen approfondi des demandes de protection. En classant certains pays comme « sûrs », l’UE risquerait, selon elle, de fermer les yeux sur les réalités locales et de priver des personnes vulnérables d’une réelle opportunité de se faire entendre.
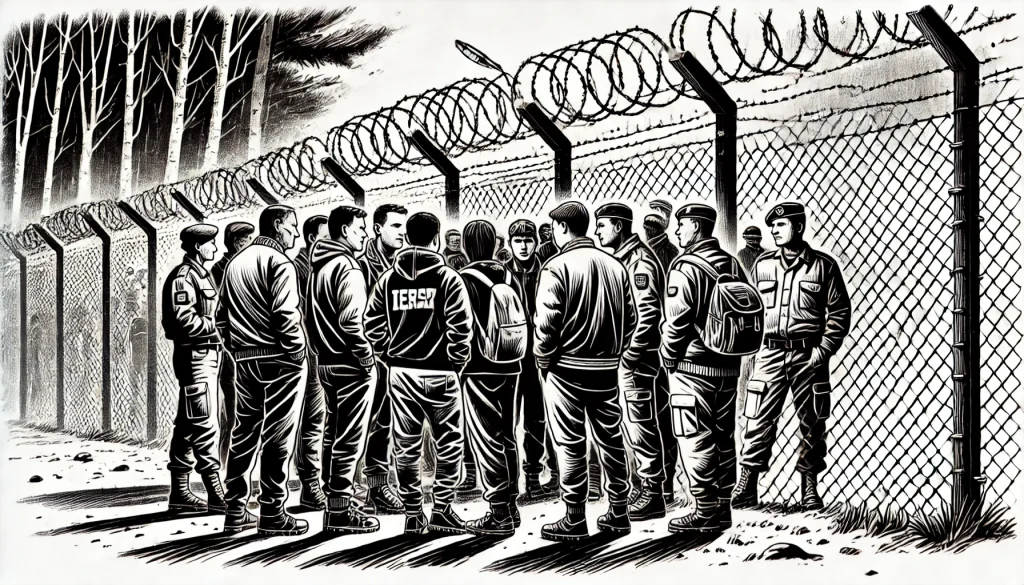
Les réalités sur le terrain contredisent la notion de « pays sûr »
Cécile Vanderstappen, chargée de plaidoyer sur la justice migratoire au CNCD-11.11.11, souligne l’incohérence entre la qualification de « sûr » et les violations des droits humains qui persistent dans les pays concernés. Elle s’interroge : « Où est la ‘sûreté’ dont parle l’Europe ? »
En Égypte, par exemple, la dernière élection présidentielle s’est déroulée dans un climat de répression, avec une vague d’arrestations arbitraires ciblant les défenseurs des droits humains et les opposants politiques. En Tunisie, le président Kais Saied gouverne par décrets depuis la suspension du parlement en juillet 2021, fragilisant l’état de droit et limitant les libertés fondamentales. De plus, un discours présidentiel jugé raciste a déclenché une vague de répression contre les personnes afrodescendantes, exacerbant les discriminations et les violences à leur encontre.
Au Maroc également, des journalistes et des voix critiques sont régulièrement confrontés à des arrestations arbitraires et à des poursuites judiciaires pour leurs activités pacifiques. Ces situations préoccupantes remettent en question la capacité de ces pays à garantir une protection effective aux demandeurs d’asile et à respecter les normes internationales en matière de droits humains.
Le risque de banaliser les violations des droits humains
Le CNCD-11.11.11 met en garde contre le risque que l’adoption de cette liste ne contribue à banaliser les violations des droits humains dans les pays tiers. En qualifiant ces pays de « sûrs », l’Union européenne pourrait involontairement légitimer des pratiques répressives et encourager d’autres États à adopter des politiques similaires.
L’organisation craint que cette approche ne conduise à une dégradation générale du système d’asile européen, en réduisant les possibilités pour les personnes persécutées de trouver refuge sur le territoire de l’Union. Elle souligne qu’une procédure d’asile équitable et rigoureuse est essentielle pour garantir le respect des droits fondamentaux et offrir une protection adéquate aux personnes vulnérables.
Vers un durcissement des politiques migratoires européennes ?
Cette proposition s’inscrit dans un contexte plus large de durcissement des politiques migratoires en Europe, marqué par une volonté accrue de contrôler les flux migratoires et de réduire le nombre de demandes d’asile. La Commission européenne a récemment présenté d’autres initiatives visant à renforcer la surveillance des frontières extérieures et à accélérer les procédures de renvoi.
Les défenseurs des droits humains dénoncent cette tendance, qu’ils considèrent comme une violation des principes fondamentaux du droit international en matière d’asile. Ils estiment que l’Union européenne a le devoir moral et juridique d’offrir une protection aux personnes persécutées, conformément à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.
Quelles perspectives pour l’avenir ?
L’adoption définitive de cette liste dépendra désormais des négociations entre le Conseil et le Parlement européens. Les organisations de défense des droits humains se mobilisent activement pour faire entendre leurs préoccupations auprès des décideurs politiques et plaider en faveur d’une approche plus respectueuse des droits fondamentaux.
Elles appellent à une évaluation rigoureuse et indépendante de la situation des droits humains dans les pays tiers, avant de les qualifier de « sûrs ». Elles insistent également sur la nécessité de garantir un accès effectif à une procédure d’asile équitable et de qualité pour tous les demandeurs, quel que soit leur pays d’origine.
L’avenir du droit d’asile en Europe est donc incertain. La décision finale concernant cette liste aura des conséquences importantes pour les personnes vulnérables qui cherchent refuge sur le continent européen. Il est crucial que les décideurs politiques prennent en compte les préoccupations légitimes des organisations de défense des droits humains et adoptent une approche responsable et respectueuse des principes fondamentaux du droit international.